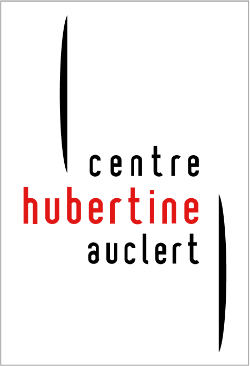L’AVFT, Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail créée en 1985, est l’association experte sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail (VSST). Elle écoute, oriente et accompagne des victimes, en particulier sur les aspects juridiques. Quand les victimes le demandent, l’association se constitue partie civile dans leur procédure pénale et elle intervient aussi volontairement devant le conseil des prud’hommes. Organisme de formation, elle a également pour rôle de de former les publics professionnels à ces questions et de leur fournir les outils dont elles et ils auront besoin pour agir à leur niveau.
Quels sont les enjeux liés à la lutte contre les VSST et les évolutions législatives et jurisprudentielles en la matière dans le secteur public ?
Un enjeu législatif actuel dont on entend beaucoup parler en ce moment c’est la redéfinition pénale du viol avec l’introduction de la notion de consentement. L’AVFT réfléchit cette question depuis un certain temps maintenant et a participé aux travaux parlementaires sur le sujet. En effet, la définition actuelle part d’une présomption de consentement des femmes, à moins que l’auteur du viol ait fait usage de menace, contrainte, surprise ou violence1.
Or, dans le cadre du travail, la contrainte n’est pas concomitante à la pénétration sexuelle, elle la précède. Sur le moment de la pénétration sexuelle, il n’y a aucun élément de contrainte mobilisé par les agresseurs, cette contrainte découle de l’organisation même du travail, notamment de la dépendance au travail pour subvenir à ses besoins.
Il nous paraît fondamental de pouvoir introduire la notion de consentement, un consentement libre et éclairé que l’on vient regarder selon les circonstances environnantes : il n’est pas question de savoir si la victime a dit oui ou non, ce qu’il faut aller chercher, c’est quel a été le contexte, les circonstances dans lesquelles elle était plongée, quels ont été les rapports de pouvoir qui l’ont empêché de consentir.
Quelles sont les obligations des collectivités en tant que structures employeuses dans la lutte contre les VSST ?
Les administrations publiques disposent de trois grandes obligations :
- Informer et prévenir les violences sexistes et sexuelles, donc l’obligation de prévention ;
- Réagir lorsqu’elles sont saisies ou informées d’un cas de VSST notamment par la protection immédiate des victimes, l’interdiction de discriminer victimes et témoins et la réalisation d’une enquête disciplinaire ;
- L’obligation de sanction, à l’issue de l’enquête disciplinaire.
Quels conseils pouvez-vous donner aux collectivités territoriales pour la mise en place de ces obligations ?
Il est fondamental que les collectivités territoriales soient au clair sur leurs obligations et leur contenu. Comme par exemple, la distinction entre ce qui est appelée une cellule d’écoute et une cellule de traitement des signalements. Ces termes sont souvent considérés comme interchangeables et peuvent prêter à confusion sur leur fonction. La distinction entre les deux cellules doit être parfaitement identifiée par les agent·es et l’administration afin que les victimes se tournent vers la structure la plus adéquate à leur situation et leurs besoins du moment.
Une cellule d’écoute a pour fonction d’outiller activement la victime : recueillir son récit, lui transmettre toutes les informations relatives à ses droits, aux démarches qu’elle peut faire et à son faisceau d’indices concordant. Cette cellule doit pouvoir lui garantir une totale confidentialité et se calquer sur la temporalité de la victime. Cette confidentialité est donc incompatible avec le fait qu’une personne ayant une délégation du pouvoir de l’employeur et/ou pouvoir disciplinaire (ressources humaines, direction des services juridiques…) y siège. En effet, dès qu’une personne ayant une délégation du pouvoir disciplinaire est informée d’une situation de violence, elle voit son obligation de réaction engagée, créant un conflit entre la confidentialité garantie par la cellule d’écoute et les obligations de l’employeur.
La cellule de traitement des signalements est la structure dans laquelle peuvent se trouver les personnes ayant une délégation du pouvoir disciplinaire. C’est la cellule qui va pouvoir réaliser cette enquête disciplinaire, donc agir, dès qu’elle reçoit un signalement.
Si les collectivités territoriales souhaitent lutter efficacement contre les VSST, il est fondamental qu’elles affirment un portage politique clair, fort et permanent. Il faut qu’elles soient claires et transparentes sur les procédures et ressources internes ainsi que la temporalité et toutes les étapes auxquelles les victimes vont être confrontées en interne une fois qu’elles saisissent la cellule de traitement des signalements. La meilleure des préventions, c’est de faire ce qu’on a dit qu’on allait faire.
Quels sont les manques dans la mise en place de ces obligations que vous constatez ?
À l’AVFT, nous remarquons tant auprès des victimes qui nous saisissent que dans les formations que nous donnons auprès des collectivités territoriales qu’il faut systématiquement rappeler l’indépendance des procédures pénales et administratives. Les collectivités ne peuvent pas se déresponsabiliser de leurs obligations juridiques en « attendant » une réponse pénale, ni même exiger qu’une victime porte plainte pour lancer une procédure disciplinaire et mettre à pied à titre conservatoire l’auteur des faits. L’argument de la présomption d’innocence étant un principe de droit pénal, les administrations ne peuvent pas s’en servir pour justifier leur refus de faire des enquêtes disciplinaires, de mettre à pied l’auteur des faits ou de le sanctionner, la présomption d’innocence n’a rien à voir avec l’obligation d’une enquête administrative.
Ce que l’on observe également, c’est le manque d’informations des victimes relatives sur leurs droits et notamment à la protection fonctionnelle. La protection fonctionnelle est un droit : protéger ses agentes et les assister si elles sont exposées à des violences est une obligation de l’administration. Et si elle est refusée, cela doit être motivé par l’administration, qui ne peut pas par exemple se contenter d’un refus implicite qui émane d’un silence de deux mois, comme constaté dans certains dossiers2. C’est un outil très protecteur mais qui est trop peu accordé, et lorsqu’il est accordé, c’est toujours au rabais sans que les agentes soient informées de ce qu’elles peuvent en exiger, alors que cette protection peut couvrir énormément de choses comme les frais d’avocat·e et tous les frais médicaux engendrés par les violences subies, etc.
Enfin, on constate un manque de sanctions adéquates des auteurs de violences. On a un grand nombre de dossiers où ils sont maintenus ou changés de service, ou suspendus un bref laps de temps. Les collectivités doivent être exemplaires en matière de sanction selon les textes de l’État3. Selon l’AVFT, la sanction la plus adéquate est la révocation : c’est la seule façon de répondre pleinement à l’obligation de sécurité. Les violences sont fondées sur l‘impunité dont bénéficient les auteurs de violence : s’ils ne perdent rien à commettre des violences, ils recommenceront, et s’ils ne recommencent pas, cela génère du stress pour les agentes qui continuent à être exposées à un individu qui a préalablement commis des violences, portant atteinte à leurs conditions de travail. Sanctionner c’est donc protéger.
Comment l’AVFT accompagne-t-elle les collectivités sur ce sujet ?
L’action des collectivités doit reposer sur un plan de formation complet sur les VSST, pas seulement des sensibilisations ponctuelles à l’occasion du 8 mars ou du 25 novembre, à destination des membres du CSE, des services RH, les membres de la cellule d’écoute et de la cellule de traitement de signalement. L’AVFT permet la réalisation de ce genre de programmes de formation, soit en interne des structures de travail, ou en inter, à raison de trois sessions par an (la prochaine session étant prévue pour octobre 2025).
En outre, la collectivité peut diffuser aux agent·es l’information sur l’aide que l’AVFT propose pour les personnes victimes : accompagnement juridique par téléphone, conseils juridiques et analyse féministe des violences, rédaction d’attestations, parfois constitution de partie civile.
L’AVFT ne dispense pas de conseil employeur, pas de conseil juridique pour les dispositifs et les enquêtes administratives mais oriente vers des avocates spécialisées.
1. La proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles adoptée le 1er avril 2025 par l'Assemblée nationale et le 18 juin 2025 par le Sénat prévoit d'introduire dans la loi la notion de non-consentement de la victime, afin de caractériser le viol et les autres agressions sexuelles. La loi devrait être promulguée d'ici fin août 2025.
2. Dans une décision du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision par laquelle l’administration avait rejeté la demande d’une femme à bénéficier de la protection fonctionnelle. Elle a également enjoint l’administration de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle en lui accordant notamment un soutien financier pour les frais engendrés par les procédures judiciaires envisagées devant les juridictions pénales, mais également les frais engagés pour les procédures administrative initiées du fait de la situation de harcèlement dont elle a été victime et des préjudices qui en ont résulté.
3. Guide Lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans la fonction publique. Guide des outils statutaires et disciplinaires, Direction générale de l'administration et de la fonction publique (2022).