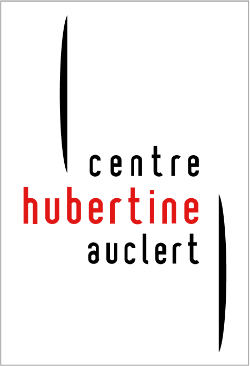Laure Lemonnier, chargée de mission égalité professionnelle et accords-cadres, et Agnès Hérault, chargée de mission inclusion prévention risques psychosociaux, présentent l'engagement et les actions du conseil régional d’Île-de-France pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail (VSST).
Quelles sont les principales actions de la Région IDF concernant la lutte contre les VSST ?
La Région Île-de-France agit concrètement contre les VSST à travers un ensemble de mesures structurées.
Tout d’abord, un dispositif d’écoute et de signalement est mis à disposition de l’ensemble des agentes et agents. En complément de la cellule RH de signalement et de la saisine possible du responsable RH, une nouvelle cellule de signalement animée par l’inspection générale de la Région Île-de-France, indépendante du pôle RH et de l’autorité hiérarchique de l’agente ou l’agent a été mise en place début 2024.
Enfin, plusieurs mesures de sensibilisations sont mises en place. En ce sens, une sensibilisation obligatoire pour les 850 cheffes et chefs d’équipe a débuté en 2025 visant à revenir sur les définitions, chiffres et enjeux de l’égalité et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, particulièrement au travail. À cette occasion la procédure du dispositif d’écoute et de signalement ainsi que la partie disciplinaire sont présentées.
À noter que les opérations de sensibilisations portent une double fonction : informer en faisant prendre conscience des situations encadrées par la loi et présenter des solutions d’écoute voire de signalement face à ces faits répréhensibles.
Aussi, tout au long de l’année, les évènements thématiques relatifs à l’égalité et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles sont l’occasion de revenir sur ces faits juridiques protégés par la loi et couverts par le dispositif d’écoute et de signalement.
Comment favorisez-vous l’identification du dispositif de signalement par les agentes et agents de la Région ?
Pour que le dispositif de signalement soit bien identifié et accessible à toutes et tous, la Région Île-de-France mise sur une communication claire sur plusieurs supports.
D’abord, une page sur l’intranet dédiée détaille les situations couvertes, les principes de fonctionnement, les garanties offertes et les modalités de contact. Une présentation commentée y est également disponible pour faciliter la compréhension et l’accessibilité.
En parallèle, l’éclatement territorial des agentes et agents des lycées a soulevé un autre enjeu d’identification du dispositif d’écoute et de signalement. Alors, pour permettre une identification au plus proche de toutes et tous sur le terrain, une large campagne de communication a été menée en 2024 afin de rendre obligatoire l’affichage mettant en exergue les informations utiles dudit dispositif dans les pièces communes (vestiaires, salles de pause…).
Les effets sont mesurables. En 2024, lors du questionnaire annuel soumis aux agentes et agents de la Région sur les actions mises en place pour favoriser l’égalité professionnelle et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, 93 % des répondantes et répondants affirmaient identifier au moins une des ressources mises en place par la Région à ce titre, dont le dispositif d’écoute et de signalement.
Comment les personnels participent à la démarche de sensibilisation sur les VSST en interne ?
La Région Île-de-France peut s’appuyer sur l’engagement d’agentes et d’agents volontaires pour faire vivre sa politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Deux réseaux internes ont été créés à cet effet.
Au siège, un réseau d’une trentaine de référentes et référents « égalité » a été formé. Leurs missions sont multiples :
- Contribuer au déploiement, dans les pôles, d’une culture de l’égalité entre les femmes et les hommes au travers de la politique RH et des politiques publiques régionales.
- Participer au rôle d’interlocuteurs et d’interlocutrices de proximité afin de libérer la parole sur le vécu de situations de violences sexistes et/ou sexuelles. Elles et ils ont à ce titre bénéficié d’une formation pour accueillir au mieux la parole des témoins et victimes et les réorienter vers les dispositifs internes ou externes à la Région.
Dans les lycées, le jeu « L’égalité sur un plateau » a été conçu en 2024 avec notamment 14 agentes et agents des lycées. Leur implication a permis de s’assurer que le jeu reflète la réalité du terrain. Cette animation vise à sensibiliser à l’égalité et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en donnant les clefs pour repérer, éviter et agir en cas de situations inappropriées. Des agentes et agents des lycées volontaires sont formés aux techniques d’animation et à l’égalité femmes-hommes afin de déployer ce jeu auprès de leurs collègues en tant qu’ambassadeurs et ambassadrices égalité.
Quelles sont les pistes de réflexions envisagées concernant la lutte contre les VSST ?
Dans le cadre de signalements de VSST, il a été observé que la seule sanction n’était pas toujours suffisante tant pour assurer une prise de conscience des auteurs que pour sécuriser la victime dans son collectif de travail. Aussi, certaines violences portées par un auteur identifié s’inscrivent dans une ambiance de travail parfois trop permissive face à certains actes ou propos. Travailler sur la prise de conscience et la responsabilisation collective face à ces violences, encore trop souvent banalisées et minimisées par l’ensemble du collectif de travail est nécessaire.
En plus de l’accroissement des mesures sur le terrain pour prévenir ces situations (obligation d’affichage du dispositif, sensibilisation obligatoire des responsables dans les lycées, sensibilisation lors des semaines thématiques, déploiement de l’animation « L’égalité sur un plateau »), des réflexions sur un accompagnement post-procédure de signalement sont donc engagées. Plusieurs outils sont expérimentés comme la Fresque du sexisme pour sensibiliser un collectif après des faits relevant du dispositif. Cette sensibilisation est un signal de protection envoyé à la victime pour mieux la sécuriser dans son environnement de travail. Enfin, l’une des pistes à creuser dans l’objectif de responsabiliser l’ensemble du collectif de travail contre les violences sexistes et sexuelles ainsi que leur banalisation semble être une déclinaison des process et méthode de la justice restaurative1. Il s’agirait d’organiser des temps d’échanges entre des victimes, des agresseurs et des tiers non liés par les mêmes infractions de violences sexistes et sexuelles au travail.
La Région est actuellement accompagnée par l’Institut national de la justice restaurative dans le cadre de ses démarches, afin de prévenir les écueils potentiels liés à la mise en œuvre de la justice restaurative, en particulier toute confusion à des fins ou procédures de médiation2.
1. La loi du 15 août 2014 introduit dans le Code de procédure pénale la notion de « justice restaurative ». Elle la définit comme une pratique complémentaire au traitement pénal de l’infraction, qui vise à restaurer le lien social endommagé. Elle s’appuie sur le dialogue entre des victimes et des auteurs d’infractions, qu’il s’agisse des parties concernées par la même affaire ou non. En France, le recours à la justice restaurative dans les cas de violences sexuelles est relativement récent et suscite encore de nombreux débats quant à ses modalités d'application et à son efficacité.
2. Note d’information du Centre Hubertine Auclert.