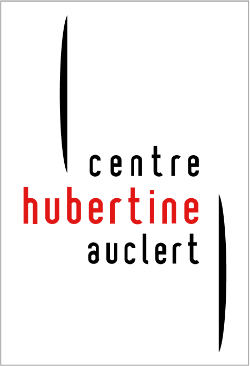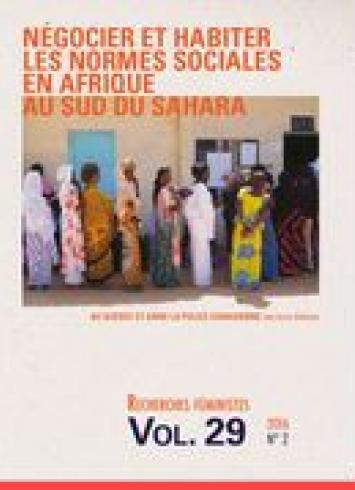Sommaire
In memoriam : Anita Caron (1927-2016), pionnière du féminisme en milieu universitaire / Marie-Andrée Roy
- Présentation : mobilisations sociales, politiques et scientifiques / Estelle Lebel
- Négocier et habiter les normes sociales en Afrique au sud du Sahara : mobilisations et extraversions sociales et politiques des femmes / Muriel Gomez-Perez et Marie Brossier
Travail-famille : un défi pour les femmes à Cotonou / Agnès Adjamagbo, Bénédicte Gastineau et Norbert Kpadonou
En Afrique de l’Ouest, le taux d’activité des femmes est élevé. Souvent cantonnées dans le secteur informel, elles contribuent pourtant de façon importante aux revenus du ménage. Toutefois, les rôles socialement prescrits imposent aux femmes la quasi-intégralité des tâches domestiques et des soins aux enfants. Cet article étudie la manière dont les femmes actives à Cotonou, au Bénin, gèrent leur quotidien entre contraintes familiales et obligations professionnelles. L’analyse montre que la conciliation incombe à toutes les femmes, quel que soit leur milieu socioéconomique. La différence se joue plutôt dans les ressources sociales et financières dont elles disposent pour pallier le fardeau de la double journée.
Les femmes propriétaires à Pikine, au Sénégal : entre nouvelles responsabilités familiales et désir d’autonomie / Émilie Pinard
Cet article porte sur les femmes propriétaires des quartiers périphériques de Pikine, au Sénégal, et sur l’intégration de leur participation accrue à la production résidentielle dans les processus d’émancipation en cours. En s’appuyant sur des entretiens narratifs auprès de 17 propriétaires, l’auteure examine les évènements et les motivations qui ont mené ces femmes à acquérir une maison, de même que les normes et les logiques dans lesquelles s’inscrit une telle démarche. L’auteure met ainsi en lumière les processus de négociations particuliers par lesquels ces propriétaires ont élargi le champ de leurs responsabilités familiales, de la gestion de l’espace domestique à la mobilisation des ressources pour la construction, tout en faisant des investissements qui favorisent leur indépendance économique et résidentielle à long terme.
- Amour, ruse et érotisme dans les transactions intimes de jeunes de la ville d’Abidjan (Côte d’Ivoire) / Boris Koenig
Cet article examine les formes des transactions intimes dans lesquelles s’engagent de jeunes citadines et citadins de Côte d’Ivoire pour atténuer la fragilité de leur situation socioéconomique. Alors que les dernières décennies ont été marquées par une détérioration des conditions d’insertion socioéconomique des jeunes, une montée du célibat féminin et un recul de l’âge à la première union, le champ des relations intimes et amoureuses constitue un point d’observation privilégié pour appréhender la manière dont s’opèrent les processus de changement sociogénérationnels. Basée sur des données ethnographiques tirées d’une étude de terrain conduite dans un quartier d’habitat précaire d’Abidjan, l’analyse porte sur les modalités par lesquelles les jeunes citadines non mariées se rapportent à l’idéologie prédominante de l’amour hétérosexuel ainsi qu’à l’ordre genré qui jalonnaient les relations intimes non maritales et extramaritales de leurs aînées.
- Le pouvoir aux marges : les femmes qui vivent avec le VIH, entre marginalité et mobilité sociale / Carolina De Rosis
L’auteure étudie les mobilités sociales engendrées par des dispositifs sociosanitaires de prévention et de prise en charge du VIH/sida parmi des femmes séropositives socialement marginalisées résidant dans la ville de Gondär, au nord-ouest de l’Éthiopie. Assujetties à un pouvoir de plus en plus orienté vers la prise en considération des individus se situant aux marges de la société pour faciliter leur autonomisation (empowerment), ces femmes entament des processus de construction identitaire au sein desquels leurs statuts sociaux sont le résultat d’arrangements et de compromis entre des rôles féminins traditionnels et les nouvelles formes de militantisme et de visibilité sociale auxquelles la lutte contre le VIH/sida a donné lieu.
- Les trajectoires des militantes d’Ibadan : le succès d’un apolitisme de façade et l’échec du militantisme politique (1947-1957) / Sara Panata
En examinant le cas de la ville d’Ibadan, au sud-ouest du Nigéria, à l’époque coloniale tardive (1947-1957), l’auteure se concentre sur l’analyse des mobilisations collectives féminines, angle d’attaque privilégié pour saisir la manière dont les femmes s’organisent afin de négocier une autonomie majeure dans le champ à la fois socioéconomique et politique. L’auteure prête attention particulièrement à la complexité de ces négociations quand ces dernières impliquent une remise en cause des assignations de genre propres à cette époque étudiée et, notamment, d’une féminité conçue autour des fonctions sociales de gardiennes du foyer, de mères et d’épouses. Les stratégies d’action et les discours déployés par les femmes sont analysés en montrant les domaines où elles ont réussi à endiguer leurs difficultés et à atteindre la visibilité recherchée, mais aussi ceux où elles ont dû se résoudre à accepter des logiques sociales encore trop enracinées pour être bouleversées.
Négocier le genre par les normes et le consensus : une association de femmes « rapatriées » à Ouagadougou / Alice Degorce
Cet article porte sur une association de femmes « rapatriées » de Côte d’Ivoire au lendemain de la guerre de 2002. Regroupant plusieurs générations, cette association intègre désormais des jeunes femmes qui n’ont pas nécessairement « fait la Côte », mais qui sont séduites par le charisme de sa présidente ou encore par les performances chantées à l’occasion de différentes cérémonies. Ces éléments pointent précisément la façon dont le genre s’avère fondamental pour le fonctionnement de l’association et permet d’aller au-delà des divisions sociales habituelles entre personnes migrantes et personnes non migrantes. Par leur rassemblement autour de la présidente de l’association, les femmes peuvent en effet faire face à des figures masculines de l’autorité. L’analyse s’oriente ainsi vers une forme de négociation des rapports de genre passant par la norme et le consensus social, qui s’articule autour du religieux, de l’expérience acquise en migration et du contexte actuel de la capitale burkinabè.
Parcours croisés d’une internationalisation du militantisme féminin au Burundi et au Libéria / Maria Martin De Almagro
L’auteure s’intéresse à l’internationalisation des militantes pour les droits des femmes au Burundi et au Libéria depuis 2003 par l’entremise d’une analyse des parcours personnel et professionnel de quatre femmes. Son étude contribue à mettre en évidence les ressorts de l’émergence d’un large espace professionnel consacré aux activités de plaidoyer pour la mise en place de l’Agenda sur les femmes, la paix et la sécurité du Conseil de sécurité des Nations unies. Ce travail vise à préciser les facteurs qui déterminent « les moments de passage » de l’activisme bénévole à la professionnalisation et à l’internationalisation.
À l’intersection entre mouvement et institution : enjeux, dynamiques et effets de l’institutionnalisation d’un espace régional de la cause des femmes / Lison Guignard
C’est à partir d’une mobilisation en faveur du protocole de Maputo et dans un contexte d’ouverture institutionnelle qu’un plaidoyer s’est institutionnalisé auprès de l’Union africaine sous l’égide de la campagne Gender is on my agenda (GIMAC), une rencontre consultative sur le genre précédant chaque sommet des chefs d’État. À la lumière de la notion d’« espace [régional] de la cause des femmes », l’auteure expose la genèse de ce plaidoyer institutionnel et ses effets.
L’agression sexuelle envers les aînées : un problème social en mal de reconnaissance / Marie Beaulieu et Marika Lussier-Therrien
En s’appuyant sur une collection de textes de référence, les auteures présentent un état des connaissances sur les agressions sexuelles envers les personnes aînées et les différentes pratiques (prévention, dépistage et intervention) s’y rapportant. Les agressions sexuelles commises envers les aînées, problème social en croissance dans divers milieux, prennent de multiples formes. Par ailleurs, la réponse des professionnelles et des professionnels de la santé et des services sociaux est teintée de méconnaissance et de non-reconnaissance. La faible quantité de textes réunis, indice du peu d’attention accordé au problème, devrait inciter le milieu de la recherche à acquérir et à développer des connaissances et des pratiques sur le sujet.
La conciliation travail-famille : l’organisation policière canadienne en transformation? / Michèle Diotte
La féminisation des corps policiers canadiens a transformé certains éléments de la culture organisationnelle et oblige à repenser la conciliation travail-famille dans ce milieu. Les rapports sur les questions d’égalité homme-femme et de diversité au sein de la police se sont multipliés au cours des dernières années et laissent entrevoir la transformation d’un modèle traditionnellement masculin en un modèle plus inclusif. Le regard féministe invite à remettre en question ce propos, car entre discours et « pratique » il y a souvent un écart. L’auteure met donc en lumière l’état des mesures qui existent actuellement dans les grands corps policiers du pays relativement à la conciliation travail-famille et s’interroge sur la matrice dans laquelle s’articule la réflexion sur ce sujet.
Les conteuses québécoises : le brouillage des stéréotypes sexués au coeur d’une pratique en quête de reconnaissance / Myriame Martineau
L’auteure trace un portrait de la pratique des conteuses au Québec, à partir d’une enquête par questionnaire. Elle interroge leur place au sein du renouveau du conte, leurs perceptions de l’art de conter et leurs prises de parole. En inversant certaines normes genrées et en valorisant des femmes « remarquables », souvent oubliées de l’histoire, les conteuses proposent de brouiller les stéréotypes sexués du conte, en offrant un nouvel espace d’oralité pour appréhender les rapports de sexe.
Les pratiques professionnelles genrées : le cas des journalistes québécoises correspondantes à l’étranger / Anne-Sophie Gobeil