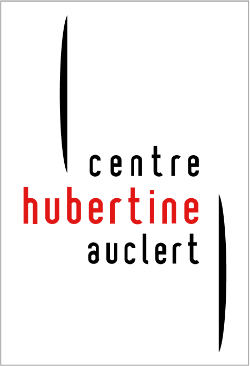Elsa Koerner est enseignante-chercheuse en sociologie et aménagement-urbanisme à l’université du Mans. Sa thèse s’intéresse à la prise en compte de l’égalité femmes-hommes dans la production des espaces végétalisés en ville dans trois villes françaises : Strasbourg, Rennes et Le Mans. Ses travaux de recherche portent notamment sur la planification urbaine au prisme du genre, la végétalisation de la ville et la sociologie de l’action publique.
Elsa Koerner est enseignante-chercheuse en sociologie et aménagement-urbanisme à l’université du Mans. Sa thèse s’intéresse à la prise en compte de l’égalité femmes-hommes dans la production des espaces végétalisés en ville dans trois villes françaises : Strasbourg, Rennes et Le Mans. Ses travaux de recherche portent notamment sur la planification urbaine au prisme du genre, la végétalisation de la ville et la sociologie de l’action publique.
Elle nous propose son éclairage en tant qu’experte sur les enjeux d’urbanisme féministe et de construction des politiques publiques en matière d’aménagement égalitaire.
Quels sont les principaux leviers sur lesquels les collectivités peuvent agir pour développer un imaginaire féministe de la ville et intégrer une culture de l’égalité dans la production urbaine ?
Ce qu’il faut commencer par dire c’est que les agent·es des collectivités adhèrent généralement bien aux objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes. La question qui se pose est plutôt celle de la définition de cette égalité, puis de sa transcription dans des aménagements urbains concrets.
Pour que cette perspective soit motrice de créativité dans la production urbaine, des formations sur la base de retours d’expériences (à l’image des fiches-actions de la troisième version du guide référentiel Genre et espaces publics de la Ville de Paris) peuvent être prévues. Cela permet de saisir quels outils ont été mobilisés, en quoi cela nourrit le projet. Souvent les agent·es disqualifient cette approche égalitaire car cela leur paraît trop éloigné de leurs préoccupations professionnelles.
Je pense aussi qu’il faut mener une réflexion en amont et en aval des projets urbains, en se focalisant sur la vision globale. Il faut notamment impliquer les équipes de maîtrise d’ouvrage afin d’inclure l’analyse de données sexuées et la diversité d’usages et de besoins dans le programme et dans l’évaluation (où travaillent les femmes, où résident-elles, quelles sont leurs chaînons de mobilité ?). Tout ce qui permet aux urbanistes et aux paysagistes de poser un regard nouveau sur leurs pratiques et sur les espaces qu’elles et ils aménagent, et qui anime leur vocation professionnelle. Donc il faut leur montrer que le féminisme fait partie de ces pistes stimulantes pour imaginer la ville de demain.
Quelles sont les principales résistances/les principaux freins que vous avez observés dans les collectivités pour intégrer le genre dans l’aménagement des espaces publics et comment les éviter/y faire face ?
Le principal frein, c’est la crainte de reproduire des stéréotypes en pensant l’espace public en termes d’usages « féminins » ou « masculins ». Il y a l’inquiétude d’associer les femmes à des images familialistes, si l’on analyse la ville à partir de la situation actuelle de division sexuée du travail domestique.
C’est aussi l’effet du cadrage médiatique qui suit une approche sécuritaire de l’espace public. Pour schématiser, si l’on conçoit l’urbanisme féministe uniquement comme la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, alors on ne se représente les femmes que comme des victimes potentielles d’agresseurs – ces suppositions visant essentiellement des hommes dominés socio-économiquement. Donc on peut légitimement craindre que cette politique soit contre-productive, en renforçant un ordre social excluant (on peut parler de genderfication). Dans mon cas d’étude [dans le cadre de ma thèse], on craignait également que cela rogne sur les avancées concernant la végétalisation des villes, en privilégiant des propositions paysagères plus maîtrisées car plus « sécurisantes », au lieu d’agir sur la conquête de leurs droits par les femmes. Les résistances ne sont donc pas uniquement anti-féministes.
C’est pourquoi les espaces de débat sont importants pour les lever, car il peut en ressortir de nouvelles pistes, pour un urbanisme plus participatif, pour l’éducation à la ville et à l’environnement, pour repenser l’animation des espaces publics.
Quelles stratégies de mise à l’agenda politique et de mobilisation des autres services avez-vous pu observer ? Qu’est-ce qui apparaissait comme le plus efficace ?
La mise à l’agenda politique, c’est le moment où le problème est pris en charge par l’instance de la collectivité pour être transcrit en politique publique. J’utilise le terme de transcription à escient car la traduction dans des outils qui seront bien appropriés par les services d’urbanisme et de paysage est essentielle pour lever les écueils cités auparavant. Avant cela, il faut bien sûr un portage politique et hiérarchique solide, bien identifié.
Le cas strasbourgeois m’a interpellée car le groupe de travail sur la thématique était porté en transversalité et de façon horizontale, même si l’élue en charge de l’égalité femmes-hommes participait régulièrement aux réunions. Ce groupe de travail a été créé à partir de la direction de l’urbanisme qui avait déjà pour habitude de travailler en transversalité, comme assistance à la maîtrise d’ouvrage pour les autres directions. En effet, des agent·es intéressé·es par la thématique, se déclarant féministes, il peut y en avoir dans tous les services, dans tous les métiers, de tout statut. C’est cette stratégie de concernement1 qui fonctionne bien à Strasbourg car cela permet la visibilité en interne de ce groupe, qui peut être sollicité en tant qu’expert·es par tout autre groupe-projet ou mission (par exemple, sur l’éclairage public, sur les jardins familiaux…). C’est un fonctionnement qui repose sur un management par projets assez avancé.
Quelle est la bonne échelle, d’après vous, pour penser un urbanisme féministe ?
La plupart des réalisations françaises qui suivent une perspective féministe en urbanisme concerne des projets de réaménagement de places, de rues, ou des projets de logements et d’équipements publics. On dispose donc d’une base d’exemples qui se fructifient. En même temps, les budgets sensibles au genre se développent et permettent d’évaluer de façon plus globale les politiques publiques.
À mon sens, le chantier principal se situe dans la planification stratégique, à l’échelle de la commune et de l’agglomération. En effet, pour sortir d’une vision sécuritaire notamment, et pour percevoir le caractère structurant du genre dans le fonctionnement des villes, il faut changer la focale des lunettes de genre. Quelles sont les mobilités des femmes ? Où travaillent-elles (quel que soit le statut de ce travail) ? À quels horaires ? Comment fait-on pour leur faciliter la vie ?
En conciliation avec les politiques temporelles, les réflexions sur le vieillissement des villes et donc le travail qu’implique le soin à autrui, le soin des choses, la bonne échelle est donc bien plus vaste que celle micro-locale. Il y a également des avancées à faire sur le logement pour qu’il soit plus modulable et sécurisant contre les violences intrafamiliales ; sur le logement collectif pour favoriser la mise en commun des tâches domestiques. Il faut considérer l’ensemble de la vie urbaine des femmes, y compris comme travailleuses.
1. Du verbe concerner – qui signifie « avoir rapport, appartient à. Cela me concerne », « être concerné : être intéressé, être touché par quelque chose » – le concernement désigne toute sensibilité orientée vers une part du monde qui s’exprime par un comportement plus ou moins actif (Brunet, 2008). À ne pas confondre avec le terme d’engagement qui implique un passage d’un état de spectateur ou spectatrice à celui d’acteur ou d’actrice ainsi que d’une visibilité publique (Brunet, 2008).