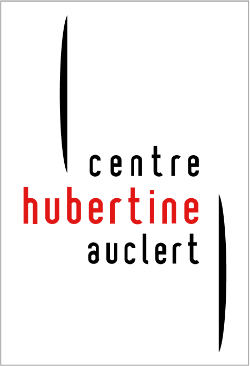Caroline Gallez, directrice de recherche à l'université Gustave Eiffel et membre du Laboratoire Ville Mobilité Transport - référente égalité, nous présente le projet européen « Fair Mobility », auquel participent le laboratoire Ville Mobilité Transport (LVMT) de l’université Gustave Eiffel et l’association Genre & Ville1.
Caroline Gallez, directrice de recherche à l'université Gustave Eiffel et membre du Laboratoire Ville Mobilité Transport - référente égalité, nous présente le projet européen « Fair Mobility », auquel participent le laboratoire Ville Mobilité Transport (LVMT) de l’université Gustave Eiffel et l’association Genre & Ville1.
Le projet vise à faciliter l’intégration du genre dans l’accès à la mobilité, en particulier dans les municipalités périurbaines et rurales. L’ambition est de produire des diagnostics approfondis des situations d’inégalité face à la mobilité et de la diversité des besoins d’accès aux aménités. Il s’agira ensuite de co-construire avec les publics concernés des outils qui préviennent et combattent les discriminations dues au genre dans les pratiques quotidiennes de mobilité.
Ces outils seront expérimentés dans deux municipalités pilotes, l’une périurbaine (Creil en France) et l’autre rurale (Ebensee en Autriche), en impliquant les publics concernés et les acteurs et actrices locales.
D’après l’enquête que vous êtes en train de mener à Creil, comment les questions de genre interfèrent-elles dans l’accès à la mobilité ?
Au début de notre enquête, plusieurs acteurs et actrices locales ont évoqué l’immobilité des femmes du Plateau, qui accueille plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville. Nous avons d’abord interprété ce propos, qui semblait peu documenté, comme relevant d’un stéréotype.
L’enquête que nous avons menée avec des femmes qui fréquentent des centres sociaux ou des associations locales nous a permis de mieux comprendre ce qui relève d’une forme de paradoxe. Aucune des habitantes que nous avons rencontrées n’est immobile, puisqu’elles fréquentent régulièrement ces lieux, mais toutes sont contraintes dans leurs déplacements. La plupart de ces femmes n’ont pas d’accès à la voiture, ou du moins pas en tant que conductrices. Lorsqu’elles se déplacent loin, pour aller travailler, ou pour accéder à des services hors du centre, par exemple l’aide alimentaire ou vestimentaire, elles dépendent d’une personne qui les accompagne, ou d’un service de bus lorsqu’il existe. Le train, lorsqu’il est adapté à leur destination, est rarement accessible financièrement. Le fait qu’elles soient « inactives », c’est-à-dire sans emploi rémunéré, ne limite pas, bien au contraire, leurs besoins de déplacement.
Celles qui s’occupent des enfants et du travail domestique ont des emplois du temps complexes, rythmés par les allers-retours vers les écoles, les centres de loisirs, le ravitaillement. Certaines, notamment les femmes réfugiées, doivent se rendre plusieurs fois par semaine dans des lieux d’apprentissage du français ou participer à des activités sociales qui font partie de leur « parcours d’intégration ». Pour la plupart de ces femmes, la marche reste le mode principal de déplacement, ce qui signifie lenteur, mais aussi transport de charge et la traversée d’environnements souvent peu adaptés et peu accueillants.
Comment les inégalités femmes-hommes peuvent-elles être renforcées par l’expérience de la mobilité ?
En tant que capacité à se déplacer dans l’espace géographique, la mobilité est centrale dans les pratiques de la vie quotidienne, et, dans une perspective temporelle plus longue, dans le parcours de vie. Les femmes, qui assument encore majoritairement le travail domestique et de soin aux personnes, ont souvent des emplois du temps plus contraints que les hommes.
Au-delà des difficultés qu’elles éprouvent au quotidien, cela peut les conduire à renoncer à occuper un emploi rémunéré à temps plein, ou un emploi rémunéré tout court. Certaines jeunes femmes que nous avons rencontrées ont renoncé à postuler pour des formations situées en dehors du territoire creillois. Le manque d’accès à la mobilité quotidienne n’est pas le seul facteur limitant dans ces situations, qui révèlent aussi des difficultés de mobilité résidentielle.
Ainsi, les freins et empêchements à la mobilité ont des conséquences à long terme, et tendent à renforcer les inégalités de genre bien au-delà de ce que l’on observe à travers les différences salariales entre les femmes et les hommes à emploi équivalent. Leur appréhension nécessite en particulier l’adoption d’une perspective intersectionnelle, qui permet de prendre en compte la manière dont les rapports de genre s’imbriquent à d’autres rapports de pouvoir, liés à la classe sociale et à la race, notamment.
Quelles actions êtes-vous en train de mettre en place à Creil pour mobiliser les habitant·es, et notamment les jeunes, autour de ces enjeux ?
Grâce aux contacts noués avec deux personnes ressources parmi les acteurs et actrices de la municipalité de Creil, nous avons proposé deux actions expérimentales. La première a consisté à organiser des ateliers entre janvier et mai 2025 avec une classe de seconde du lycée André Malraux à Montataire, commune voisine de Creil. L’objectif était de recueillir l’expérience et la parole des jeunes. Nous avons organisé six séances de travail, au cours desquelles nous avons travaillé sur le mouvement des corps dans l’espace, les émotions et les ressentis, les expériences de la mobilité, les discriminations croisées et les violences et les mobilités rêvées, désirées.
Les élèves ont produit un manifeste des mobilités poétiques, avec dix propositions pour améliorer l’égalité dans l’espace public. Ce travail a été présenté à six classes de seconde du lycée le 27 mai 2025, il a fait l’objet de publications sur le compte Instagram du lycée et d’inscriptions à la craie dans la cour. Par ailleurs, nous avons co-organisé avec Juliette Soissons, chargée de mission au développement social et urbain de la ville de Creil, une semaine de la mixité dans l’espace publicdu 10 au 13 juin 2025. Nous avons proposé des formations pour acteurs et actrices du territoire, des marches sensibles, des ateliers de construction d’un bus idéal. Nous avons également discuté avec les élu·es des résultats de notre enquête.
Au-delà de la sensibilisation, l’objectif est de placer les personnes en situation, afin qu’elles et ils réfléchissent autrement aux enjeux de l’égalité dans l’espace public.
D’après vous, comment les collectivités peuvent-elles intégrer au mieux les enjeux de genre dans leurs politiques de mobilité ?
L’égalité face à la mobilité relève de problèmes globaux, auxquels les politiques de mobilité, seules, ne peuvent pas répondre. Si l’on reprend l’exemple de l’égalité dans l’accès aux formations, elle relève autant de mesures concernant l’orientation (ouvrir les possibles pour des jeunes femmes parfois cantonnées aux formations dans le domaine social), le logement étudiant (garantir un logement abordable à proximité des centres de formation), la tarification des transports collectifs, que l’éducation nationale, avec la déconstruction des stéréotypes de genre.
Intégrer les enjeux de genre dans les politiques locales, ce n’est pas se contenter d’adopter des orientations générales visant une plus grande parité femmes-hommes. C’est indispensable, mais ce n’est pas suffisant, car cela ne permet pas de comprendre comment se construisent et se perpétuent des rapports sociaux inégalitaires. Il faut partir de l’identification des problèmes, admettre leur complexité, et réfléchir à la coordination des politiques publiques.
Par exemple, l’égalité dans l’espace public ne peut se réduire à des problématiques de sécurité. Si la lutte contre le harcèlement, les agressions et les violences est indispensable, elle ne relève pas de la simple installation de lampadaires dans les rues mal éclairées. Elle demande une déconstruction plus profonde de ce qui produit le sentiment d’insécurité des femmes dès l’enfance, de la fabrication et de la diffusion des stéréotypes, de la perpétuation des violences et de leur banalisation.
Cela passe par l’éducation et la formation, la lutte contre toutes les formes de discriminations, autant que par des actions de (ré)aménagement des espaces publics et des mesures garantissent une plus grande égalité d’accès aux services de mobilité.
1. L’équipe est constituée de Chris Blache et Pascale Lapalud (Genre & Ville), Angèle Brachet, Maya El Khawand, Caroline Gallez, Lucie Girardin et April Tourot (LVMT, Université Gustave Eiffel).