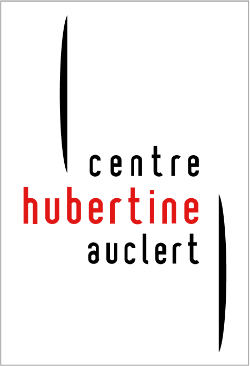Bozena Wojciechowski, chargée de mission Droits des femmes présente les actions de la Ville de Montreuil en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSST).
Comment la Ville de Montreuil intègre-t-elle les enjeux de lutte contre les VSST dans sa politique publique ?
La Ville de Montreuil développe une politique publique importante autour de la problématique des violences faites aux femmes, et ce, de longue date. Parmi les domaines concernés, la question du travail s’est également posée. Si le passage du monde du travail, en général, à la particularité locale, avec la proximité des lieux de travail de l’administration communale, a pu interroger certain·es, le portage politique fort du Maire a clairement hissé les enjeux à un haut niveau d’exemplarité, en particulier des cadres. Il serait inadéquat d’affirmer que toutes les interrogations ont disparu, mais ce portage politique fort est un point d’appui précieux. Y compris pour lever les réticences liées à la méconnaissance ou à l’inconfort face à des situations « inhabituelles ». Là, il « suffit » de former, de sensibiliser, de montrer que ces situations de violences sexistes et sexuelles n’ont pas leur place au travail et qu’on peut les résoudre de différentes façons.
Ainsi, la mise en place du dispositif de signalement, obligatoire pour les collectivités, s’est accompagnée d’une réflexion approfondie sur sa forme, son périmètre et son fonctionnement. Des actions de formations se sont déroulées : avant la création du dispositif, en direction de l’ensemble des agent·es, puis au moment de son déploiement, pour les membres référent·es du dispositif. La procédure de signalement est de plus en plus connue et reconnue.
Comment fonctionne la cellule et en quoi le fonctionnement du dispositif de signalement permet une mobilisation globale des services de la collectivité ?
La mise en place de la cellule est encore « récente » et la mobilité des personnels remet régulièrement l’ouvrage sur le métier à tisser. Mais l’expérimentation prend forme. Les enseignements sont tirés régulièrement et le plus collectivement possible.
Le dispositif répond à une charte de fonctionnement qui, entre autres, assure la notion de confidentialité. Il comprend une cellule d’écoutant·es qui recueille les témoignages et les anonymise pour les présenter en commission « Acte de Violences, Discriminations, Harcèlement, Agissement Sexiste » (AVDHAS) dont la composition est pluridisciplinaire.
Les écoutant·es sont : l’assistante sociale du personnel, la psychologue du travail, et les conseillères conjugales et familiales des centres de santé sexuelle (au sein des centres municipaux de santé). Il y a donc déjà deux directions référentes de l’écoute : la DRH et la direction de la santé.
La commission, placée sous la responsabilité du service Qualité de vie au travail (QVT), est composée : du directeur des ressources humaines et de son adjointe, du responsable de service QVT, des écoutant·es, d’un·e juriste de la direction des Affaires civiles et juridiques, du correspondant Ville/Justice de la direction de la tranquillité publique, de la chargée de mission Droits des femmes au sein de la direction de la citoyenneté et de la vie des quartiers, ainsi que de représentant·es du personnel communal.
Cette commission se réunit toutes les six semaines et émet des préconisations tant au niveau individuel que collectif au regard des situations signalées. Ces préconisations sont ensuite transmises en interne à la direction des ressources humaines et à la direction générale afin de mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires1.
Quelles sont les modalités permettant de construire une culture commune de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail ?
La pluridisciplinarité est une vraie richesse : chacun·e apporte son expertise « métier », son point de vue, son analyse des situations. Pour parvenir à ce que la diversité se nourrisse réellement, il est essentiel d’en créer le cadre. Trois éléments apparaissent essentiels pour y parvenir :
- La régularité des commissions : elles se tiennent toutes les six semaines, « quoi qu’il arrive » ou presque. Elles sont calées dans l’agenda longtemps à l’avance, permettant à chacun·e de s’organiser. Ainsi, les membres apprennent à se connaître, se rencontrent régulièrement, sont amenés à partager de plus en plus de situations et de retours sur celles-ci. La commission se réunit, même quand il n’y a pas de signalement, ce qui permet un échange de pratiques et une réflexion actualisée sur le dispositif.
- C’est le deuxième point : un bilan, des évaluations régulières et partagées. Prendre ce temps est incontournable.
- Enfin, le renforcement d’une culture commune autour de l’égalité, des violences sexistes et sexuelles, des discriminations, des conséquences des violences sur le travail mais aussi sur les témoignages… Les membres de la commission AVDHAS ont reçu une « formation initiale » à la création du dispositif et continue de se former sur ces enjeux.
À cela s’ajoute des actions qui dépassent le seul dispositif de signalement : les sensibilisations, formations, ateliers en direction de l’ensemble des agent·es et des cadres, que ce soit à l’occasion du 25 novembre ou dans le cadre du Plan d’action pour l’égalité professionnelle, tout cela contribue, peu à peu, à créer un collectif de travail moins perméable au sexisme.
1. Complément d’information apporté par le Centre Hubertine Auclert (suite à un entretien en avril 2025).