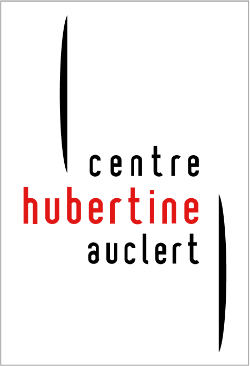En octobre 2022, le Digital Services Act (DSA) a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Ce texte, combiné au Digital Market Act (DMA) renouvelle le cadre européen en matière de régulation des grandes entreprises du numérique. Me Rachel-Flore Pardo, avocate au barreau de Paris, co-fondatrice de l’association Stop Fisha et co-rédactrice de l’ouvrage Combattre le cybersexisme, revient sur cette avancée législative et les impacts pour la lutte contre les cyberviolences sexistes, sexuelles et LGBTphobes.
En décembre 2020, deux projets de loi européens ont été présentés pour renouveler les règles d’encadrement des plateformes en ligne. En effet, jusqu’ici prévalait la directive européenne adoptée en 2000, à une époque où les réseaux sociaux n’en étaient qu’à leurs débuts. Il y avait donc un véritable enjeu à adapter le cadre européen aux récentes évolutions du cyberespace. Il fallut moins de deux ans pour que ces règlements soient adoptés, au terme de nombreux débats.
Nous nous intéresserons ici exclusivement au DSA qui a vocation à réguler les services numériques et notamment la modération des contenus, alors que le DMA porte sur les marchés numériques. Le DSA entrera en application en février 2024, sauf pour les grandes plateformes de plus de 45 millions d’utilisateurs et utilisatrices (soit environ 10% de la population européenne) par mois – comme Google, Facebook, Snapchat, TikTok, Twitter, YouTube, etc. – qui seront concernées dès cette année 2023.
Quels sont les leviers d’action au niveau européen pour lutter contre ces cyberviolences ?
Par ailleurs, une directive visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence conjugale a été proposée par la Commission européenne le 8 mars 2022. Ce texte, qui est aujourd’hui étudié par le Parlement européen, sera la première législation spécifique de l’Union Européenne sur ces enjeux et consacre un certain nombre d’articles à la reconnaissance des cyberviolences sexistes et sexuelles.
Quelles sont les principales avancées du DSA en matière de lutte contre les cyberviolences sexistes, sexuelles et LGBTphobes ?
Le DSA est composé d’une série d’obligations : la plateforme doit désigner un ou une interlocutrice dans les États européens, elle doit dévoiler le nombre de personnes affiliées à la modération et prouver qu’elle se donne les moyens d’avoir une modération efficace. Il y a aussi une obligation de coopération judiciaire, entre autres...
Cependant, le DSA ne concerne que les très grosses plateformes qui rassemblent plus de 45 millions d’utilisateurs et utilisatrices. Or cela s’est fait sur un principe déclaratif, et des plateformes comme Airbnb ou Telegram ont déclaré moins de 45 millions d’utilisateurs et utilisatrices. C’est un véritable problème car en matière de cyberviolences sexistes et sexuelles, Telegram joue un rôle important. L’application Telegram permet de créer des groupes rassemblant un très grand nombre de personnes quand bien même la modération de la plateforme est quasi inexistante. C’est notamment une des plateformes où se sont développés les comptes fisha (visant à diffuser des contenus intimes de filles et de femmes sans leur consentement dans le but de les humilier).
Plusieurs militant·es européen·nes, dont des militantes de Stop Fisha, se sont mobilisé·es pour soutenir l’article 24b sur la régulation des sites pornographiques (qui hébergent de nombreuses images/vidéos diffusées sans le consentement) qui a finalement été retiré.
Quels étaient les enjeux ?
L’enjeu était d’imposer aux sites de vérifier l’identité de ceux qui publient des contenus par la transmission systématique d’une adresse e-mail et d’un numéro de téléphone, d’investir plus de moyens dans la modération humaine des contenus, et d’assurer aux victimes de diffusion de contenus sans consentement la possibilité de contacter le site pour solliciter leur suppression. Mais l’article 24b n’a pas été adopté. Sur ce point, le DSA est une occasion manquée de mieux protéger les victimes de diffusion de contenus intimes sans consentement sur les sites pornographiques.
Dans ce décryptage, Me Rachel-Flore Pardo rappelle l’importance d’un meilleur encadrement des plateformes par le cadre légal (européen et national) afin de pouvoir lutter plus efficacement contre les cyberviolences sexistes, sexuelles et LGBTphobes.