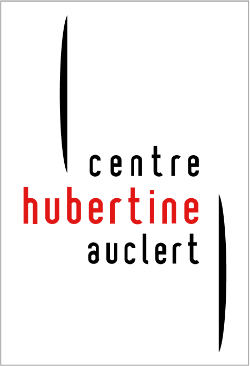Dans le cadre des violences conjugales, le contrôle de la localisation et des déplacements (direct ou différé) est un des mécanismes des agresseurs afin d’accroître leur emprise, de restreindre l’autonomie des victimes et ainsi renforcer l’isolement de ces dernières. C’était la thématique du deuxième webinaire du cycle du Centre Hubertine Auclert sur les cyberviolences sexistes et sexuelles.
Pour approfondir cet enjeu, ce décryptage propose une interview de Marion Tillous, maîtresse de conférences à l’Université Paris 8 en géographie et études de genre et rattachée au Laboratoire d’études de genre et de sexualité (LEGS). Elle a notamment dirigé l’ouvrage Espace, genre et violences conjugales : ce que révèle la crise de la covid-19 qui paraît ce mois-ci.
Dans le cadre des violences conjugales, comment les agresseurs mettent-ils en place des stratégies pour contrôler et/ou limiter les déplacements des victimes ?
- D’une part, le contrôle spatial direct qui se matérialise par le fait de délimiter les cadres autorisés du déplacement : périmètre de déplacement, heures de sorties autorisées, modes de transports accessibles, motifs considérés comme légitimes pour le déplacement, etc. L’agresseur peut aller jusqu’à définir les modalités de présentation de soi dans l’espace public (habit, maquillage, posture, etc.) et d’interaction avec d’autres personnes (regard, sourire, parole, etc.).
- Pour s’assurer que les cadres définis pour les déplacements de sa victime sont bien respectés, le partenaire violent met en place tout un système de surveillance spatiale. Cela peut passer par des logiciels espions, mais c’est loin d’être le seul moyen : il peut aussi recourir à des applications détournées de leur usage, à des réseaux sociaux incluant la position spatiale, à des balises GPS, à la jauge à essence, au compteur kilométrique ou au GPS de la voiture, à des caméras de surveillance, ou il peut tout simplement demander à des proches. La surveillance spatiale peut être réalisée à la connaissance ou à l’insu de la victime.
- Au-delà du contrôle spatial direct et de la surveillance spatiale, de nombreux autres aspects du « contrôle coercitif » (Stark, 2007) caractéristique des violences conjugales impactent les pratiques spatiales des victimes, les endroits qu’elles fréquentent, les manières dont elles se déplacent. Le fait que la victime soit progressivement coupée de ses proches, qu’elle perde son emploi, ou l’injonction aux tâches domestiques modèlent sa mobilité. Enfin, tous les aspects de la violence qui visent à briser la confiance en soi de la victime et ses capacités de décision ont des conséquences négatives sur sa mobilité.